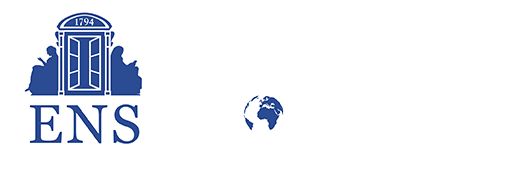Matérialités historiques : biogéochimie territoriale & histoire environnementale
Champ disciplinaire : Société
Niveau : M1 ou M2
Crédits : 3 ECTS
[/vc_column]
Responsable pédagogique : Julia Le Noë (IRD & ENS Géosciences)
Intervanent.e.s : Julia Le Noë (IRD & ENS Géosciences), Christophe Bonneuil (Centre de Rech. Historiques, Cnrs-Ehess), Clémence Gadenne-Rosfelder (CRH, Ehess), Gilles Billen (DR Emerite, Sorbonne Université) et Céline Pessis (AgroParisTech)
Évaluation : Rendus écrits (3 pages) et exposés intermédiaires (20 minutes). Exercice de restitution finale : 20 minutes de présentation suivie de 10 minutes de questions et un débat final avec l’ensemble des groupes d’étudiant.es. Nous demandons également un rapport de 8-10 pages maximum (police 12, interligne 1,15, marge normale) figures incluses références biblio non comprises. Nous demandons aussi d’attacher les données analysées sous forme d’un tableur Excel.
11 séances les jeudis du 21 septembre au 18 janvier de 16h à 19h (sauf le 18 janvier 16h-20h) – Salle Froidevaux (314), ENS, 24 rue Lhomond, 75005 Paris
UE commune aux Masters « Études Environnementales » de l’EHESS et « Géosciences » de l’ENS
Il s’agit de se former à des méthodes permettant d’accéder aux dimensions matérielles et écologiques de l’histoire, en prenant comme cas d’étude l’histoire des transformations de l’agriculture en France depuis le milieu du XIXème siècle. Cette unité d’enseignement présente une approche fondamentalement interdisciplinaire s’appuyant sur les outils méthodologiques de la biogéochimie territoriale, tels que l’analyse quantitative des flux et la modélisation, et sur des cadres d’analyse proposés par l’histoire environnementale et la political ecology.
21 sept. Séance « 0 » pour les étudiants scientifiques – Introduction aux approches SHS des enjeux environnementaux
Petite introduction à l’épistémologie des SHS pour néophytes à partir du livre Génocide Tropicaux de Mike Davis : Comment l’approche SHS permet-elle de dénaturaliser les questions environnementales et d’historiciser les savoirs. Présentation à cinq voix des pratiques de l’interdisciplinarité autour de différents objets de recherche.
26 oct. Introduction générale – ambitions du cours, cadres conceptuelles et méthodologiques.
Notre principal objet d’étude est les sols et plus particulièrement les sols agricoles, objet bio-géo-chimique et objet socio-historique que nous appréhendons grâce au cadre conceptuel du métabolisme socio-écologique, qui vise à articuler une sphère sociale à une sphère biophysique sans pour autant assimiler l’une à l’autre. Afin de rendre opérationnelle ce cadre, nous nous appuierons sur les outils méthodologiques de la biogéochimie territoriale qui permet de formaliser une vision des flux de matière afin de décrire et de modéliser le fonctionnement biophysique des socio-écosystèmes. Les relations dites économiques peuvent alors être analysées comme l’expression de rapports de forces sociales impliquant des dynamiques matérielles dans l’extraction et la distribution des ressources. On s’intéressera tout particulièrement aux cycles du carbone et de l’azote et le cours sera ainsi l’occasion de quelques rappels essentiels du fonctionnement de ces cycles. Présentation des exercices intermédiaires (petit rendu écrit pour 21 novembre et exposés de groupe 14 Décembre) et de l’exercice final (analyse des trajectoires et prospective future dans cinq territoires).
2 nov. Le système terre, l’azote, le carbone et l’agriculture entrent dans le capitalisme industriel (19e-20e siècles) et TD jeu sérieux « Rebattre les cartes du système agro-alimentaire mondial ».
Nous présentons la trajectoire historique d’intégration des produits de l’agriculture et du foncier rural aux marchés économiques mondiaux et les conséquences de cette intégration sur le fonctionnement écologique des agroécosystèmes. Cette intégration aux marchés économiques est pensée comme une composante essentielle de la dynamique global d’accumulation du capital. Cette première partie du cours est suivi d’un TD brise-glace autour du jeu sérieux « Rebattre les cartes du système agro-alimentaire mondial ».
9 nov. Agriculture et systèmes-mondes : les 3 “Food Regimes” depuis 1850 et leurs dimensions métaboliques (1)
Dans cette séance, nous nous intéressons au premier food regime (1870-1940), centré sur la Grande Bretagne. Nous articulons cette théorie des food regime à une compréhension du fonctionnement biogéochimique des systèmes agricoles et forestier : agriculture minière et lente afforestation aux USA, poly-culture-élevage et lente afforestation en Europe, plantation de canne à sucre et déforestation dans les pays colonisés. Alors que nous nous appuyons sur un cadre d’analyse définit dans le champ des sciences politiques, nous proposons de relier les rapports de pouvoir et vision de monde à l’œuvre dans le 1er food regime aux perturbations des cycles du C et de l’N engendrés par les changements d’approvisionnement alimentaires et énergétiques et changement d’usage des sols associés. Une analyse en termes d’échange écologique inégale et de dette écologique est également développés.
16 nov. : Agriculture et systèmes-mondes : les 3 “Food Regimes” depuis 1850 et leurs dimensions métaboliques (2)
Nous présentons les deuxième (1940-1985) et troisième (1985-) food regime centrés respectivement sur les États-Unis et sur les grands groupes de l’agro-business transnationaux. Ici encore, nous prévoyons d’articuler cette théorie à une analyse biogéochimique des systèmes agricoles et forestiers: intensification et spécialisation agricoles rendues possibles par l’agriculture à hauts intrants industriels et la motorisation, persévérance d’une agriculture vivrière dans certaines régions du monde, mouvement de ‘re-biologisation’ et ‘reterritorialisation’ de l’agriculture dans les pays des Nords, transition des forêts (i.e., afforestation ) qui se poursuit dans les pays de la première industrialisation et qui s’amorce dans certains pays de l’ancien bloc communiste (Russie, URSS) tandis que les pays d’Afrique centrale et d’Amérique du Sud restent soumis à une déforestation alarmante pour le climat et désastreuse pour les populations autochtones. Les conséquences des rapports de force à l’œuvre durant cette période historique sur les cycles du C et de l’N et sur les changements d’affectation et d’usage des sols sont examinés à l’aune d’une perspective hybride mêlant political ecology, histoire environnementale et biogéochimie territoriale.
21 nov : Envoi par chaque groupe de devoirs écrits « Mon territoire, comment est-il articulé aux 3 Food Regimes » (3 pages) discutés à la séance suivante (23 novembre).
23 nov. Trajectoire socio-écologique de l’agriculture française, 1850-2020
Nous changeons d’échelle pour nous intéresser aux trajectoires politiques et biogéochimiques singulières de l’usage des sols de la France dans sa diversité territoriale. Ce changement d’échelle permet d’aborder avec plus de finesse les logiques à l’œuvre dans les changements des pratiques agricoles et d’usage des sols en France. On s’appuiera pour cela sur une approche hybride croisant analyse quantitative des flux biogéochimique, analyse des politiques publiques agricoles en France et histoire par en bas des organisations syndicales, citoyennes, corporatiste et ouvrières qui distordent, voire contrecarrent, la mise en œuvre de ces politiques sur les territoires.
Une discussion en petits groupes est engagée entre avec les tuteurs de chaque groupe sur les rendus écrit de l’avant-veille « Mon territoire, comment est-il articulé aux 3 Food Regimes ».
7 déc. Modélisation et prise en main du modèle GRAFOLU
L’objectif de cette séance est d’abord de développer une compréhension épistémologique des modèles comme démarche scientifique et présenter en quoi il représente un paradigme scientifique relativement nouveau. Puis le cours vise à permettre une prise en main efficace d’un tableur excel plus complexe intégrant les modèle GRAFS (pour les systèmes agricoles) et CRAFT (pour les systèmes forestiers) dans une représentation plus large des flux biogéochimiques d’azote et de carbone à l’échelle territoriale. L’objectif de cette séance est de permettre une prise en main du tableur que les étudiant.e.s utiliseront pour l’exercice final. Afin de se familiariser le plus possible avec les données de l’exercice finale, nous prenons le cas des cinq mêmes territoires que ceux sur lesquels chaque groupe d’étudiant.e.s a déjà rendu un rapport écrit de trois pages et présent un exposé oral.
14 déc. Exposés oraux « Mon territoire, comment est-il articulé aux 3 Food Regimes » s’appuyant sur les rendus écrits du 21 novembre, améliorés et approfondis par les discussions avec les tuteurs de chaque groupe lors de la séance du 23 novembre.
21 déc. Stratégies du changement et scénarisation des futurs
Cette séance s’interroge d’abord sur la notion de ‘scénarios’ qui a connu un essor spectaculaire depuis le début des années 1990, avec notamment les premiers scénarios du GIEC. Longtemps réservés au seul domaine des lettres, le recours aux récits fictifs, que l’on peut aussi appréhender comme fiction pétrie de sciences, introduit de nouvelles pratiques dans le champ scientifique mais également de nouvelles postures des acteurs du monde scientifique vis-à-vis de celles et ceux pour qui et avec qui ces récits sont produits. Fort de cette réflexion, nous nous appuyons ensuite sur le livre Utopie Réelles su sociologue américain Erik Olin Wright pour développer une méthode de construction de « scénarios scientifiques », tenant compte tant des réalités physiques que des réalités sociales du monde. Les différentes étapes de cette méthode considèrent donc d’abord la question de la désirabilité des futurs possibles, puis celle de leurs possibilités biophysiques et enfin celle de leur venue au monde par et dans la réalité sociale. Cette dernière étape implique d’identifier les obstacles culturels, économiques, institutionnelles et politiques aux changements souhaités, d’identifier les acteurs et groupes sociaux pouvant s’allier pour contourner, dépasser ou affronter ces obstacles et, enfin, d’établir à proprement parler une stratégie du changement social par ces acteurs/ groupes sociaux qui font l’histoire, mais dans des conditions qu’ils et elles n’ont pas choisi.
11 janv. : Travail en groupes sur des territoires-cas
Cette séance est dédiée à du travail en petits groupes visant à préparer l’exercice de restitution finale dont les objectifs déjà introduits lors des séances précédentes seront à nouveau rappeler. Il s’agira pour les étudiant.e.s de proposer une analyse historique et biogéochimique du territoire qu’ils ont choisi en s’appuyant pour cela sur :
- Des données historiques dont les étudiant.es devront discuter la fiabilité,
- Le modèle biogéochimique déjà pris en main lors de la séance 7 Décembre,
- Des documents historiques de seconde main déjà analysés dans le cadre du premier rendu écrit et de l’exposé intermédiaire.
A partir de l’analyse historique, les étudiants de chaque groupe devront ensuite s’appuyer sur les notions de ‘dépendance au sentier’, ‘d’espace biophysique des possibles’, de ‘stratégie du changement social’ introduit dans la séance du 7 Décembre pour proposer une prospective d’usage des sols pour l’approvisionnement en biomasse (alimentaire, énergétique, autres) dans la région qu’ils étudient à l’horizon 2050. L’exercice de prospective inclut une analyse des verrous socio-politiques et techniques susceptibles de faire obstacle aux changements proposés et une analyse des flux et bilan de matière associés à ces changements.
18 janv. Restitution orale finale (EXCEPTIONNELLEMENT DE 16h-20h)